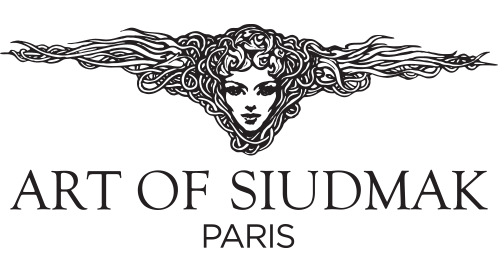Siudmak aime l’inconfort : il se proclame hyperréaliste fantastique, il se réclame d’Ingres et de Dalí. Sa position peut sembler paradoxale ; elle devient claire dès qu’on a sous les yeux l’une de ses toiles.Celle qui figure sur la couverture du présent volume est hyperréaliste, au premier degré, par le travail impeccable de Siudmak, par son souci constant de tout rendre crédible, y compris ce qui n’est pas actuellement vrai, par son ambition manifeste de convaincre ou au besoin de mystifier. Le choix d’une technique froide, où le coup de pinceau ne se voit plus, permet au peintre de concurrencer le réel : la touche, qui signe le leurre – et qui, dans la tradition critique dominante, signe l’auteur – tend à l’invisibilité ; le créateur s’efface, en offrant son monde luxuriant à nos regards médusés. Il n’y a plus de sujet, ni derrière les pinceaux de l’artiste, ni même derrière nos regards. C’est là une part du programme hyperréaliste ; ce fut jadis une part du programme d’Ingres, lequel disait déjà : “La touche, si habile soit-elle, ne doit pas être apparente : sinon, elle empêche l’illusion et immobilise tout. Au lieu de l’objet représenté, elle fait voir le procédé.”
Mais la ressemblance avec l’hyperréalisme s’arrête là. Pour Siudmak, la technique n’est qu’une question d’intendance ; les photos et plus généralement les modèles au second degré – par exemple les tableaux reproduits dans les livres d’art – sont tout au plus des accessoires, des pistes d’envol pour une inspiration qui trouve sa source d’énergie ailleurs ; le goût du travail bien fait ne peut être à lui-même sa propre justification. Ce qui importe, c’est d’abord le contenu : plus le message est dérangeant et insolite, plus l’auteur a besoin de techniques fascinantes, presque hypnotiques, pour l’imposer à son public. Un peintre compétent n’a pas de mal à faire exister son univers ; sa démarche n’a de sens que si cet univers en vaut la peine, s’il apporte au spectateur unsupplément d’être.
Le monde extérieur est banal, il est le bien commun de l’artiste et du public, pour qui la technique froide, le seul univers digne d’être représenté, c’est celui qui n’existe pas ou qui plutôt n’existe que dans l’esprit. Comme le disait déjà André Breton en 1928 : “L’oeuvre plastique, pour répondre à la nécessité de révision absolue de valeurs réelles sur laquelle aujourd’hui tous les esprits s’accordent, se référera donc à un modèle purement intérieur, ou ne sera pas.” (“Le surréalisme et la peinture”).
Siudmak assume ici une part du programme surréaliste et plus particulièrement du programme de Dalí. Pourquoi lui alors qu’un Magritte, par exemple, a des idées qui annoncent fréquemment Siudmak ? Parce que la technique de Dalí est infiniment plus belle, et que son classicisme prémédité crée un effet de choc, faisant ressortir la force des idées et la présence hallucinatoire de l’impossible ; il veut que la peinture soit une “photographie à la main et en couleurs” de ce qu’il a dans la tête. Comme le disait encore Breton : “C’est sans doute dans la mesure même où l’artiste est apte à reproduire, à objectiver par la peinture ou par tout autre moyen les objets extérieurs dont il subit douloureusement la contrainte, qu’il échappe pour une grande part à la tyrannie de ces objets et évite de verser dans la psychose proprement dite.” (“Le cas Dalí”).
L’autre point de rencontre entre Siudmak et Dalí, c’est ce que ce dernier appela naguère, non sans abus de langage “l’activité paranoïaque-critique”. Cette appellation, née du penchant surréaliste pour la psychanalyse et le délire, recouvre en fait un profond infléchissement de la pratique des surréalistes, invités à limiter l’empire de l’inconscient et du hasard et à augmenter celui de l’interprétation et de la construction intellectuelle que Dalí range un peu arbitrairement sous la bannière de la paranoïa : “L’activité paranoïaque-critique ne considère plus isolément les phénomènes et images surréalistes, mais au contraire dans un ensemble cohérent de rapports systématiques et significatifs.” (“La conquête de l’irrationnel”).
A supposer que Dalí ait jamais été paranoïaque, il est clair que Siudmak ne l’est pas. Il est non moins clair qu’il aime les édifices conceptuels et les allégories qui viennent superposer à ses tableaux un sens second dans la composition même et à l’occasion un sens troisième dans le titre du tableau, voire un sens quatrième quand le tableau sert d’illustration de couverture à un roman avec lequel il forme contraste ou entre en perspective.
On a remarqué que la science-fiction est politique : elle nous concerne tous, ensemble et séparément. On sait aussi qu’elle est cosmique : elle nous rappelle que l’homme n’est pas le maître du monde, qu’il est sans cesse confronté à l’inhumain, aussi bien en lui-même que hors de lui. Il faudra bien voir un jour que sur ce point la S.-F. est la forme la plus actuelle de la tragédie. On se rappelle la formule de Jean Giraudoux : “Qu’est-ce que la tragédie ? C’est l’affirmation d’un lien horrible entre l’humanité et un destin plus grand que le destin humain.” Les dieux antiques, les Moires, les Parques, et la fatalité sont devenus les bombes, les machines, les mutants, les extraterrestres, les robots, les pièges du temps, tous les possibles que notre imagination peut rêver tant que notre génie ne les a pas réalisés – sans oublier bien sûr, les morts-vivants, les monstres, les fantômes, les démons, les sorciers, qui les ont précédés dans la carrière. Les auteurs d’aujourd’hui n’ont pas lu Sophocle, Shakespeare ou Racine, mais Dick, Herbert ou Jeury ; beaucoup affectionnent l’humour à la Sheckley, d’ailleurs éminemment avec le tragique. La SF porte en elle toute l’inquiétude moderne ; et, avec Siudmak, elle en tire de la beauté.
Cette présence au monde, ce besoin de traduire en images les problèmes qui nous concernent, ont trouvé dans la S.-F., littérature d’idées, un terrain plus fertile que n’est l’art réaliste ou engagé. Qu’est-ce qu’un problème sinon une rupture locale de l’ordre du monde, une contradiction entre deux exigences ? Qu’est-ce qu’une idée neuve sinon un pont jeté entre deux termes ordinairement distincts ? On n’est pas loin de la pratique surréaliste du collage, choc imprévu qui crée du jamais vu avec du déjà vu ; et, plus loin dans le temps, on trouve la vieille tradition mythologique et picturale des monstres composites comme la Chimère, assemblages paradoxaux de parties du corps individuellement orthodoxes. Michel-Ange – autre modèle de Siudmak – disait déjà : “Quand, pour le délassement et la diversion des sens, comme pour la récréation des yeux mortels qui parfois désirent voir ce qu’ils n’ont jamais vu et dont l’existence leur semble impossible, le peintre introduit dans une oeuvre… quelques êtres chimériques, il se montre plus respectueux de la raison que s’il y introduisait… l’habituelle figure de l’homme ou celles des animaux.” Cette raison-là est bien proche de la S.-F. ; elle n’associe les idées qu’en associant les images, les parties séparées du corps ou du monde, pour en tirer des questions faites du chair, des concentrés de perplexité, des objets qui affichent leur existence d’autant plus péremptoirement que leur cohérence est incertaine. Ce qui n’est pas si loin de l’hyperréalisme, ou plutôt d’une inquiétude qui plane sur l’hyperréalisme : le monde, a-t-il un sens ? le monde existe-t-il ?
Nous avons tous le pouvoir de rêver l’impossible ; seul l’artiste – un Siudmak, par exemple – a le pouvoir de le faire exister, et par la même, de nous aider à rêver. Nous nous demandons toujours pourquoi Dieu a créé le monde ; c’est tout simplement qu’il en a eu envie. Certains ont suggéré qu’il avait créé le monde pour être moins seul et nous avons du mal à nous persuader qu’il y a quelque vérité dans cette hypothèse. Citons Jacques Lacan : “On dit que ça vous regarde, de ce qui requiert votre attention… de ce qui vous regarde sans vous regarder, vous ne connaissez pas l’angoisse.” Nous ne connaissons pas l’angoisse de nos pères, nous ne comprenons pas que nous sommes issus de leur désir, nous ne savons pas que nous sommes aussi nécessaires, et mystérieux pour eux, qu’ils le sont pour nous. Nous sommes leurs fétiches, nous nous éprouvons vides de sens et nous ignorons que nous sommes leur sens.
Siudmak peint comme Dieu a créé le monde ; les amateurs de romantisme et de tranches de vie méconnaîtront toujours la dimension prométhéenne de son entreprise. Pourtant, l’objet impossible est là, brillant, immobile, fascinant par sa fixité même. Michel Nuridsany souligne l’envoûtement que font naître ces femmes et ces hommes “en attente, comme suspendus dans un liquide amniotique.” Le paradoxe est plus vif encore pour George Lucas, ce prince de l’image mouvante qui reconnaît la séduction de l’image arrêtée, riche d’un passé et d’un avenir énigmatiques, morte ou encore à naître en surface et fourmillant de vie profonde. Entre le cinéaste et le peintre, il y a l’abîme qui sépare “La Guerre des étoiles” de la paix des étoiles. Pourtant Lucas, qui est un maître du récit, admet que les tableaux de Siudmak se prolongent dans un ailleurs, alors que le récit converge vers une fin, une clôture. Chose étonnante : l’insolite affleure au fond de l’académisme et le mystère au fond de la transparence.
C’est la paix, mais la paix armée. Peut-être y a-t-il quelque malentendu, pour Siudmak comme pour Ingres – à qui son ennemi Baudelaire reconnaissait “une espèce d’idéal fait moitié de santé, moitié de calme, presque d’indifférence.” C’est la vérité, mais ce n’est pas toute la vérité. Dans “Jupiter et Thétis” , Siudmak décèle non de la grâce et de l’harmonie, mais une force incroyable ; Ingres peut obtenir un effet géant même dans un petit dessin. De même, chez Michel-Ange ou chez le Dalí du “Christ de saint Jean de la Croix” : ces maîtres de l’équilibre sont des maîtres de l’excès. S’ils soignent tant la composition, c’est qu’il y a en eux une force qui tend à la faire chavirer ; s’ils imitent leurs modèles, c’est qu’ils ont trop d’imagination. Même Baudelaire décelait chez Ingres “la conscience d’un milieu fantasmatique, je dirais plutôt d’un milieu qui se veut fantasmatique” ; la chute n’est pas sans perfidie, mais on peut en retourner le sens, pour peu qu’on se souvienne du mot de Magritte : “L’art de peindre mérite vraiment de s’appeler l’art de la ressemblance lors qu’il consiste à peindre l’image d’une pensée qui ressemble au monde : ressembler étant un acte spontané de la pensée et non un rapport de similitude raisonnable ou délirant.” L’image d’une pensée qui ressemble au monde, c’est tout simplement l’imagination. On peut bien dire d’elle, avec Baudelaire, qu’elle “se veut” fantasmatique, puisqu’elle travaille toujours en miroir ; mais a le pouvoir de faire exister des objets par la pensée, donc de les faire ressembler au monde. Qu’elle les fasse exister par le pinceau et qu’elle crée le monde. Peut-être ce mondelà, n’est-il créé que pour mourir et pour nous faire assister à sa mise à mort […]. Mais qu’importe ? Le tableau reste là pour témoigner ; ses arabesques épousent un raz-de-marée ; son chant orchestre un cri. Siudmak un jour s’est senti trop seul. Et il est devenu dieu.
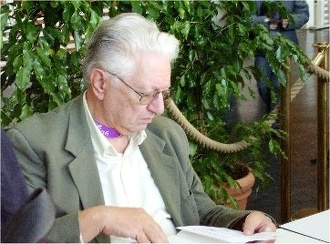
Jacques Goimard
From Wikipedia, the free encyclopedia